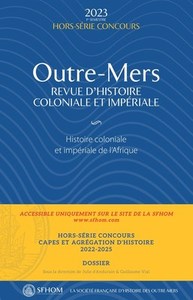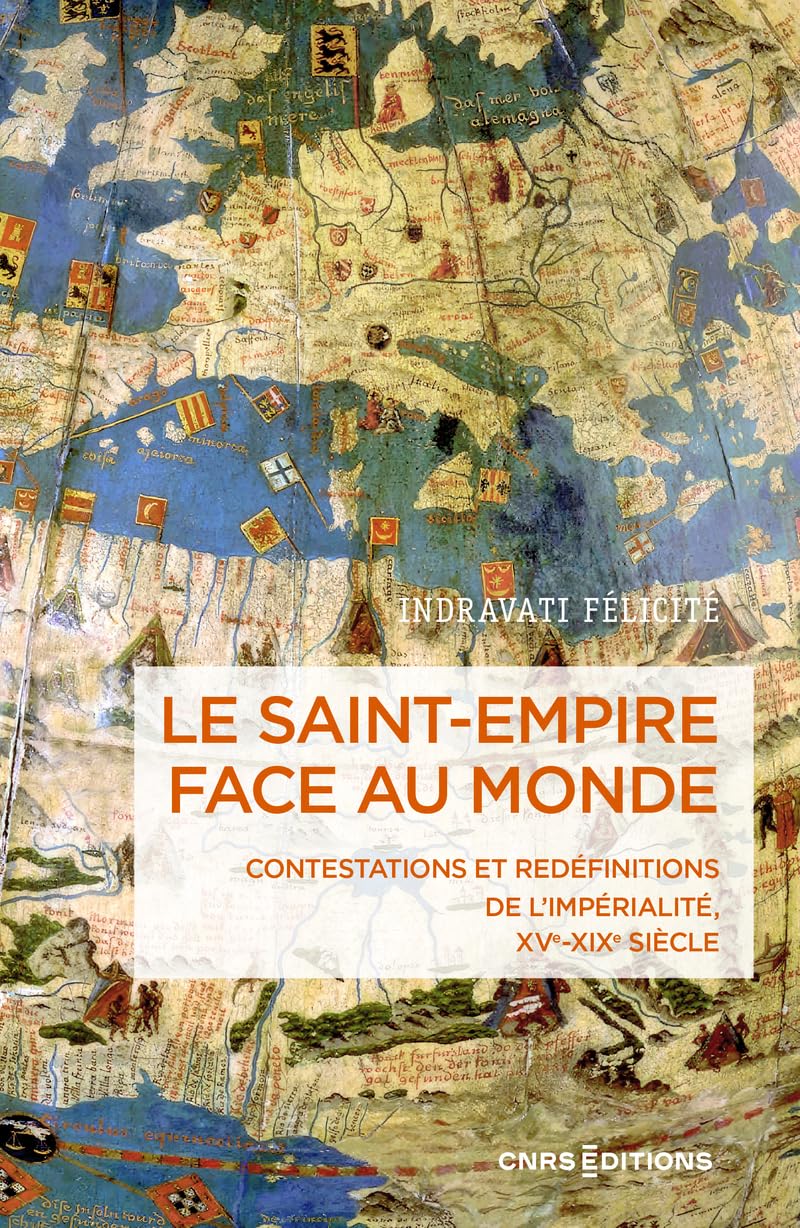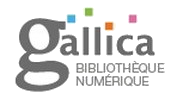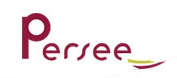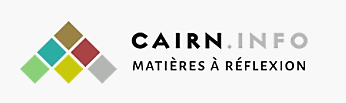Le site web de la Société française d’histoire des outre-mers (S
Articles les plus récents
-
Hors-Série Concours de la S
fhom - Capes et Agrégation d’histoire, 2022-2025Commander (10 €) le hors-série Histoire coloniale et impériale de l’Afrique :
https://www.payasso.fr/librairie-sfhom/commandes -
Vient de paraître le dossier "Napoléon et l’esclavage" de Pierre
Branda et ThierryLentz dans Napoleonica. La revue (Fondation Napoléon)Le 11 juillet 2024 à 17h28
Vient de paraître le dossier "Napoléon et l’esclavage" de Pierre
Branda et ThierryLentz dans Napoleonica. La revue (Fondation Napoléon), 2024-2, n° 49, 156 p. Prix : 7 € (pour la version papier, disponible sur Cairn).
La version numérique du dossier est accessible gratuitement sur Cairn.info, en intégralité.
-
Vient de paraître Aux marges des grands royaumes. Une histoire orale de Maroua, Afrique centrale de Christian
Seignobos et HenryTourneux aux éditions du CNRSLe 11 juillet 2024 à 17h07
Vient de paraître Aux marges des grands royaumes. Une histoire orale de Maroua, Afrique centrale de Christian
Seignobos et HenryTourneux aux éditions du CNRS, coll. "Zéna", 2024, 576 p. ISBN : 978-2-271-15153-7 Prix : 28 € (existe également en version numérique).
"Comment articuler histoire et tradition orale ? À cette question structurelle pour l’histoire de l’Afrique – et bien au-delà –, il est répondu ici par l’exemple, par l’établissement d’une source nouvelle : les récits historiques de la région de Maroua, aujourd’hui au nord du Cameroun, du traditionniste Oumarou Tchinda, enregistré au tournant des années 1980 et 1990. Placés en première partie du volume, ces récits originaux en fulfulde, traduits en français, conservent toute la spontanéité et la musicalité de la parole vive. Ils sont éclairés par une introduction qui donne les clés de l’histoire de la région et présente les conditions d’enquête comme celles de l’établissement du texte. En deuxième partie, la chronique en langue originale est enrichie d’un vaste commentaire, nourri des récits de plusieurs autres traditionnistes rencontrés et enregistrés au fil des années, parmi lesquels Saïdou Mal Hamadou et Hamadou Dalil.
Cet ensemble documentaire d’une très grande richesse permet de revenir sur les principaux moments qui ont marqué la région du XVIIIe au début du XXe siècle – entre conquête peule, chefferies traditionnelles et période coloniale. Il nous transmet des mémoires enchâssées conduisant de la période mythique des hommes à queue qui vivaient jadis dans les termitières jusqu’aux hauts faits de Zigla Greng, le prince des brigands, qui défrayait la chronique à l’heure de l’occupation allemande."
ChristianSeignobos , géographe, et HenryTourneux (https://x.com/Henry_Karthala), linguiste, ont tous deux appartenu au CNRS et à l’IRD. Spécialistes de l’Afrique centrale, ils ont notamment travaillé en tandem sur des sociétés et des langues en voie de disparition au Tchad. Ils ont collaboré, pour ce volume, avec Abdourahman Nassourou, Maliki Wassili et Yaya Daïrou. -
Vient de paraître Au carrefour des Afriques subsahariennes et de leurs diasporas. Dire, écrire et traduire l’histoire, les histoires sous la direction de Mamadou
Bâ et al. aux Presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine/La GesteLe 11 juillet 2024 à 16h46
Vient de paraître Au carrefour des Afriques subsahariennes et de leurs diasporas. Dire, écrire et traduire l’histoire, les histoires sous la direction de Mamadou
Bâ , CécileBertin-Elisabeth , RaymondMbassi Atéba , Corinne Mencé-Caster et ÉrickNoël aux Presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine/La Geste, 2024, 288 p. ISBN : 979-10-353-2484-1 Prix : 29,90 €.
"Dire, écrire et traduire les Afriques subsahariennes ? Un défi lorsque les représentations occidentalo-centrées perdurent et re-colonisent de façon incessante…
Interroger la notion de carrefour entre ces Afriques et leurs diasporas, en partant de l’idée de croisement et non de fusion, inviter à repenser les inventions coloniales à la lumière des réinventions diasporiques, n’est-ce pas une façon de dire et de traduire les mémoires et les imaginaires pluriels qui les accompagnent ?
Cet ouvrage propose donc de réfléchir à l’écriture et à la traduction comme une machine à réhumaniser, un espace de relances multiples entre les altérités." -
Vient de paraître The Cambridge History of the Age of Atlantic Revolutions sous la direction de Wim
Klooster aux Cambridge University PressLe 10 juillet 2024 à 14h31
Vient de paraître The Cambridge History of the Age of Atlantic Revolutions sous la direction de Wim
Klooster aux Cambridge University Press, 3 vol., 2023. ISBN : 9781108567817 Prix : 320 £ (existe également en version électronique).
"In three volumes, The Cambridge History of the Age of Atlantic Revolutions brings together experts on all corners of the Atlantic World who reveal the age in all its complexity. The Age of Atlantic Revolutions formed the transition from an era marked by monarchical rule, privileges, and colonialism to an age that stood out for republican rule, legal equality, and the sovereignty of American nations. The seventy-one chapters included reflect the latest trends and discussions on this transformative part of history, highlighting not only the causes, key events, and consequences of the revolutions, but stressing the political experimentation, contingency, and survival of colonial institutions. The volumes also examine the attempts of enslaved and indigenous people, and free people of color, to change their plight, offering a much-needed revision to R.R. Palmer’s first synthesis of this era sixty years ago."
WimKlooster is the Robert H. and Virginia N. Scotland Chair and Professor of History and International Relations at Clark University. He is the (co-) author and (co-) editor of twelve books. His monograph The Dutch Moment : War, Trade, and Settlement in the Seventeenth Century Atlantic World (2016) won the Biennial Book Award of the Forum on Early-Modern Empires and Global Interactions and the Hendricks Award of the New Netherland Institute.
Volume 1, The Enlightenment and the British Colonies, XI-564 p. ISBN : 9781108476034 Prix : 120 £ (existe également en version électronique).
"Volume I offers an introduction to the Enlightenment, which served as the shared background for virtually all revolutionary turmoil, and the American Revolution, which inaugurated the Age of Revolutions. Beginning with a thorough introduction, the volume covers international rivalry, the importance of slavery, and the reformist mind-set that prevailed on the eve of the revolutionary era. It addresses the traditional argument on whether the Enlightenment truly caused revolutions, concluding that the reverse is more apt : revolutions helped create the Enlightenment as a body of thought. The volume continues with a regional and thematic assessment of the American Revolution, revealing how numerous groups in British America – including Black and indigenous people – pursued their own agendas and faced interests at odds with the principles of the revolution."
Volume 2, France, Europe, and Haiti, XIII-790 p. ISBN : 9781108475983 Prix : 120 £ (existe également en version électronique).
"Volume II delves into the revolutions of France, Europe, and Haiti, with particular focus on the French Revolution and the changes it wrought. The demarcation between property and power, and the changes in family life, religious practices, and socio-economic relations are explored, as well as the preoccupation with violence and terror, both of which were conspicuous aspects of the revolution. Simultaneous movements in England, Germany, Hungary, Ireland, Italy, and Poland-Lithuania are also discussed. The volume ends with the Haitian Revolution and its impact on neighboring countries, revealing how the revolution was comprised of several smaller revolutions, and how, once the independent black State of Haiti was established, an effort was made to fulfill the promises of freedom and equality."
Volume 3, The Iberian Empires, XIII-790 p. ISBN : 9781108475969 Prix : 120 £ (existe également en version électronique).
"Volume III covers the Iberian Empires and the important ethnic dimension of the Ibero-American independence movements, revealing the contrasting dynamics created by the Spanish imperial crisis at home and in the colonies. It bears out the experimental nature of political changes, the shared experiences and contrasts across different areas, and the connections to the revolutionary French Caribbean. The special nature of the emancipatory processes launched in the European metropoles of Spain and Portugal is explored, as are the connections between Spanish America and Brazil, as well as between Brazil and Portuguese Africa. It ends with an assessment of Brazil and how the survival of slavery is shown to have been essential to the new monarchy, although simultaneously, enslaved people began pressing their own demands, just like the indigenous population."
-
Vient de paraître Encyclopédie noire. The Making of Moreau de Saint-Méry’s Intellectual World de Sara E.
Johnson aux University of North Carolina PressLe 10 mai 2024 à 19h01
Vient de paraître Encyclopédie noire. The Making of Moreau de Saint-Méry’s Intellectual World de Sara E.
Johnson aux University of North Carolina Press, coll. "Omohundro Institute of Early American History", 2023, 392 p. ISBN : 978-1-4696-7691-3 Prix : 45 $ (existe également en version électronique).
"If you peer closely into the bookstores, salons, and diplomatic circles of the eighteenth-century Atlantic world, Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry is bound to appear. As a lawyer, philosophe, and Enlightenment polymath, Moreau created and compiled an immense archive that remains a vital window into the social, political, and intellectual fault lines of the Age of Revolutions. But the gilded spines and elegant designs that decorate his archive obscure the truth : Moreau’s achievements were predicated upon the work of enslaved people and free people of color. Their labor afforded him the leisure to research, think, and write. Their rich intellectual and linguistic cultures filled the pages of his most applauded works. Every beautiful book Moreau produced contains an embedded story of hidden violence.
Sara Johnson’s arresting investigation of race and knowledge in the revolutionary Atlantic surrounds Moreau with the African-descended people he worked so hard to erase, immersing him in a vibrant community of language innovators, forgers of kinship networks, and world travelers who strove to create their own social and political lives. Built from archival fragments, creative speculation, and audacious intellectual courage, Encyclopédie noire is a communal biography of the women and men who made Moreau’s world."
Sara E.Johnson is professor of literature of the Americas at University of California, San Diego. -
Vient de paraître The Driver’s Story. Labor and Power in the World of Atlantic Slavery de Randy M.
Browne aux University of Pennsylvania PressLe 10 mai 2024 à 17h15
Vient de paraître The Driver’s Story. Labor and Power in the World of Atlantic Slavery de Randy M.
Browne aux University of Pennsylvania Press, coll. "Early American Studies", 2024, 224 p. ISBN : 978-1-5128-2586-2 Prix : 39,95 $ (existe également en version électronique).
"The story of the driver is the story of Atlantic slavery. Starting in the seventeenth-century Caribbean, enslavers developed the driving system to solve their fundamental problem : how to extract labor from captive workers who had every reason to resist. In this system, enslaved Black drivers were tasked with supervising and punishing other enslaved laborers. In The Driver’s Story, Randy M. Browne illuminates the predicament and harrowing struggles of these men—and sometimes women—at the heart of the plantation world. What, Browne asks, did it mean to be trapped between the insatiable labor demands of white plantation authorities and the constant resistance of one’s fellow enslaved laborers ?
In this insightful and unsettling account of slavery and racial capitalism, Browne shows that on plantations across the Americas, drivers were at the center of enslaved people’s working lives, social relationships, and struggles against slavery. Drivers enforced labor discipline and confronted the resistance of their fellow enslaved laborers, aiming to maintain a position that helped them survive in a world where enslaved people were treated as disposable. Drivers also protected the people they supervised, negotiating workloads and customary rights to essentials like food and rest with white authorities. Within the slave community, drivers helped other enslaved people create a sense of belonging, as husbands and fathers, as Big Men, and as leaders of diasporic African “nations.” Sometimes, drivers even organized rebellions, sabotaging the very system they were appointed to support.
Compelling and original, The Driver’s Story enriches our understanding of the never-ending war between enslavers and enslaved laborers by focusing on its front line. It also brings us face-to-face with the horror of capitalist labor exploitation."
Randy M.Browne (https://twitter.com/randymbrowne) is Associate Professor of History at Xavier University and author of Surviving Slavery in the British Caribbean, also available from the University of Pennsylvania Press. -
Vient de paraître Jacques Louis David, la traite négrière et l’esclavage. Son séjour à Nantes, mars-avril 1790 de Philippe
Bordes aux Éditions de la Maison des sciences de l’homme, avec le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK Paris)Le 10 mai 2024 à 12h53
Vient de paraître Jacques Louis David, la traite négrière et l’esclavage. Son séjour à Nantes, mars-avril 1790 de Philippe
Bordes aux Éditions de la Maison des sciences de l’homme avec le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK Paris), coll. "Passerelles", 2023, 173 p. ISBN : 978-2-7351-2968-3 Prix : 12 €.
Le livre est également disponible sur OpenEdition Books.
"De son voyage à Nantes au printemps 1790, Jacques Louis David rapporta une vaste composition allégorique, inspirée par l’esprit révolutionnaire qui avait très tôt pris racine dans la cité portuaire. Le présent essai en propose une analyse serrée soulignant que, lors de son séjour dans le premier port négrier de France, le peintre fut inévitablement confronté à la réalité du commerce des esclaves. En déchiffrant la polysémie iconographique de son dessin, Philippe Bordes y voit une métaphore de l’esclavage – ou plus exactement d’un esclavage Noir-Blanc, dans le double sens colonial et métropolitain – que David voulut y déployer. Il met en lien cette composition avec l’influence de son entourage parisien, qui comptait plusieurs membres de la Société des Amis des Noirs, et avec les vifs débats sur l’abolition de la traite négrière au sein de l’Assemblée nationale et en dehors. L’histoire renouvelée du séjour nantais de David se révèle alors comme le moment de l’entrée en Révolution de ce géant de la peinture en tant que citoyen et artiste."
PhilippeBordes est professeur émérite d’histoire de l’art de l’université de Lyon. Depuis ses études à Stanford, au Courtauld à Londres, puis à la Sorbonne, il s’efforce de changer le regard porté sur la vie artistique à l’époque de la Révolution française et d’en démontrer la vitalité. Ses travaux sont nombreux sur Jacques Louis David, tels son livre sur le Serment du Jeu de Paume en 1983 et le catalogue d’exposition Empire to Exile en 2005. En complément d’une carrière universitaire en France et à l’étranger, il a participé à la création du musée de la Révolution française au château de Vizille, dont il a été le premier directeur de 1984 à 1996. -
Vient de paraître The Gift. How Objects of Prestige Shaped the Atlantic Slave Trade and Colonialism d’Ana Lucia
Araujo aux Cambridge University PressLe 10 mai 2024 à 07h52
Vient de paraître The Gift. How Objects of Prestige Shaped the Atlantic Slave Trade and Colonialism d’Ana Lucia
Araujo aux Cambridge University Press, coll. "Cambridge Studies on the African Diaspora", 2023, XIX-224 ISBN : 978-1-108-83929-7 Prix : 30 £ existe également en version électronique).
"The Gift explores how objects of prestige contributed to cross-cultural exchanges between Africans and Europeans during the Atlantic slave trade. An eighteenth-century silver ceremonial sword, commissioned in the port of La Rochelle by French traders, was offered as a gift to an African commercial agent in the port of Cabinda (Kingdom of Ngoyo), in twenty-first century Angola. Slave traders carried this object from Cabinda to Abomey, the capital of the Kingdom of Dahomey in twenty-first century’s Republic of Benin, from where French officers looted the item in the late nineteenth century. Drawing on a rich set of sources in French, English, and Portuguese, as well as artifacts housed in museums across Europe and the Americas, Ana Lucia Araujo illuminates how luxury objects impacted European–African relations, and how these economic, cultural, and social interactions paved the way for the European conquest and colonization of West Africa and West Central Africa."
Ana LuciaAraujo (https://twitter.com/araujohistorian) is a Professor of History at Howard University. A specialist on the history and memory of slavery and the Atlantic slave trade, she has authored and edited thirteen books. -
Vient de paraître Des scouts en Malaisie britannique. Une histoire de la mondialisation culturelle de la jeunesse de Christina Jialin
Wu aux Presses de Sciences PoLe 10 mai 2024 à 07h26
Vient de paraître Des scouts en Malaisie britannique. Une histoire de la mondialisation culturelle de la jeunesse de Christina Jialin
Wu aux Presses de Sciences Po, 2024, 310 p. ISBN : 978-2-7246-4195-0 Prix : 27 €.
La version électronique est disponible sur Cairn.info.
"En partant de sources orales et écrites peu connues, cet ouvrage propose une histoire originale de la circulation des idées et des modèles, de l’universel au local. Elle contribue ainsi à une histoire sociale et globale subtile de la colonisation et de la décolonisation.
De Kuala Lumpur à Singapour, le mouvement scout comme celui des guides s’implantent en Malaisie britannique à partir des années 1910. Parce que leurs camps sont ouverts aux différentes communautés qui composent l’archipel - les Occidentaux évidemment, les autochtones malais, mais aussi les Chinois, les Indiens ou autres peuples de l’Empire britannique attirés par la prospérité relative de la région - ils deviennent, sinon un lieu de brassage, du moins un lieu d’échange. Le paradoxe du scoutisme s’y révèle : l’instrument (nationaliste) imaginé par Robert Baden-Powell au service de la société impériale britannique, participe de la construction d’une jeunesse qui partage, à l’échelle du monde, jeux et rires.
Avec les mouvements indépendantistes, il sert à nouveau des projets nationaux, et son modèle pédagogique et idéologique est même vanté pour tenir à l’écart le communisme.
En partant de sources orales et écrites peu connues, Christina Jialin Wu propose une histoire originale de la circulation des idées et des modèles, de l’universel au local. Elle contribue ainsi à une histoire sociale et globale subtile de la colonisation et de la décolonisation."
Historienne, Christina JialinWu est maitresse de conférences à l’université Paris 1. -
Vient de paraître Le Saint-Empire face au monde. Contestations et redéfinitions de l’impérialité, XVe-XIXe siècle d’Indravati
Félicité aux CNRS éditionsLe 25 avril 2024 à 14h27
Vient de paraître Le Saint-Empire face au monde. Contestations et redéfinitions de l’impérialité, XVe-XIXe siècle d’Indravati
Félicité aux CNRS éditions, 2024, 453 p. ISBN : 978-2-271-14631-1 Prix : 27 € (existe également en version numérique).
"Le monde germanique a-t-il pris part au tournant global de l’époque moderne et au processus de conquête et de colonisation qui l’a caractérisée ? Le Saint-Empire romain germanique, perçu alors comme l’une des formations politiques les plus importantes, est aujourd’hui largement absent des travaux consacrés aux empires. Ce fut pourtant un acteur majeur des relations internationales du XVe au début du XIXe siècle.
Indravati Félicité montre comment cette entité s’est confrontée au monde, la débarrassant ainsi de l’image de « vieil empire » qu’on lui a souvent prêtée. Marqué par une dimension continentale forte, le Saint-Empire n’en a pas moins été intégré au commerce mondial et inséré dans des réseaux internationaux. Ses habitants ont contribué par leurs voyages et leurs publications à la connaissance de contrées méconnues, ils ont noué des contacts politiques avec diverses nations extraeuropéennes, ont pensé leur place dans un monde en interdépendance croissante.
Indravati Félicité nous fait redécouvrir cet empire connecté, et propose, ce faisant, une réflexion sur les notions d’empire et d’impérialité."
IndravatiFélicité (https://twitter.com/FIndravati) est historienne. Elle est notamment l’auteure de Négocier pour exister. Les villes et duchés du nord de l’Empire face à la France, 1650-1730 (2016) et a dirigé L’Identité du diplomate (Moyen Âge-XIXe siècle). Métier ou noble loisir ? (2020).
- page précédente
- page suivante